Les îles
Galapagos sont situées à quelques 1000 Km à l’Ouest
des côtes équatoriennes. L’archipel compte 19 îles et
une quarantaine d’îlots ou rochers. Il est entièrement volcanique
et constitué d’îles purement océaniques, par opposition
aux îles dites " continentales ". Une île continentale a comme
caractéristique d’avoir dans le passé été reliée
au continent par une bande de terre et possède en conséquence
une flore et une faune typique de la masse continentale dont elle est issue.
Au contraire, une île océanique naît d’un volcan sous
marin qui aura émergé et est donc dépourvue de toute
vie organique au départ.
|
 |
| Climat.
Bien que situées sur l’équateur, les îles Galapagos ne connaissent pas un climat équatorial mais subtropical. Cette caractéristique résulte de la confluence de plusieurs courants marins. Venant du Sud-Est, les eaux froides du courant de Humboldt remontent jusqu’aux îles septentrionales de l’archipel, tandis que les îles situées plus au Nord sont influencées par le courant de Panama qui amène des eaux beaucoup plus chaudes. Les différences de température de l’eau sont impressionnantes; dans les îles du Sud il est impossible de faire de la plongée sous marine sans une grosse combinaison, alors qu’au nord, un maillot de bain suffit pour explorer les fonds marins. Il n’y a pourtant que quelques dizaines de Km qui séparent ces îles. L’intensité de ces courants varie de mois en mois de sorte que deux saisons bien distinctes se succèdent. En plus de ces phénomènes annuels
il arrive qu’ " El Nino " fasse son apparition. El Nino, c’est un
afflux inhabituellement important d’eaux chaudes provenant du continent
Sud-américain. Ce réchauffement des eaux entraîne des
pluies et un taux d’humidité beaucoup plus importants que la normale.
Ces dérèglements ont des conséquences néfaste
sur l’équilibre de l’archipel. L’année 1998 est précisément
une année El Nino et nous avons pu constater nous-mêmes les
conséquences néfastes du phénomène sur la faune.
En effet, à notre arrivée sur l’île de Genovesa, nous
avons vu de nombreuses otaries mortes sur les plages. Nous apprîmes
plus tard que c’était la température trop élevée
de l’eau qui avait causé leur décès.
|
Sans entrer dans trop de détails,
l’archipel est situé à peu près à l’intersection
de trois plaques océaniques et en étau entre deux rides sous-marines.
L’archipel constitue en outre un " point chaud ", de par la faiblesse de
la croûte océanique sous-marine sur laquelle il repose. Il
en résulte une zone d’une fragilité remarquable, et l’activité
volcanique intense donne lieu à des éruptions pratiquement
annuelles. En effet, la faiblesse de la croûte a pour conséquence
que le magma sous-jacent troue fréquemment la plaque, créant
ainsi un cône volcanique sous-marin qui, en quelques millions d’années,
parvient à la surface, formant une île.
|
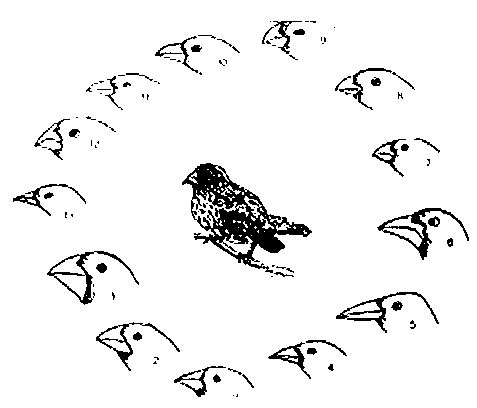 Cette
notamment sur base de l’observation des nombreux pinsons de l’archipel
que Charles Darwin a élaboré sa théorie. Aux Galapagos,
les 14 espèces de pinsons ont évolué à partir
d’une seule espèce originelle, venue du Costa Rica. Chez les pinsons
de l’île originelle, l’accroissement de la communauté provoqua
le départ d’un certain nombre d’individus vers d’autres habitats,
et chaque nouvelle île colonisée donne par la suite autant
d’espèces uniques, adaptées à un environnement spécifique.
Ce phénomène est appelé le rayonnement adaptif. Les
pinsons des Galapagos se différentient essentiellement par la grosseur
et la forme de leur bec dictées par les conditions d’habitat et
les possibilités alimentaires qu’ils ont rencontrées au cours
de leurs migrations d’une île à l’autre. Il y a ainsi des
pinsons végétariens, chanteurs, à bec aiguisé,
carpentiers, pinsons de terre, des arbres, des cactus.
Cette
notamment sur base de l’observation des nombreux pinsons de l’archipel
que Charles Darwin a élaboré sa théorie. Aux Galapagos,
les 14 espèces de pinsons ont évolué à partir
d’une seule espèce originelle, venue du Costa Rica. Chez les pinsons
de l’île originelle, l’accroissement de la communauté provoqua
le départ d’un certain nombre d’individus vers d’autres habitats,
et chaque nouvelle île colonisée donne par la suite autant
d’espèces uniques, adaptées à un environnement spécifique.
Ce phénomène est appelé le rayonnement adaptif. Les
pinsons des Galapagos se différentient essentiellement par la grosseur
et la forme de leur bec dictées par les conditions d’habitat et
les possibilités alimentaires qu’ils ont rencontrées au cours
de leurs migrations d’une île à l’autre. Il y a ainsi des
pinsons végétariens, chanteurs, à bec aiguisé,
carpentiers, pinsons de terre, des arbres, des cactus.
 Seul lézard marin du monde, l’iguane
des Galapagos est présent sur toutes les côtes rocheuses de
l’archipel. Ils se rassemblent en hordes d’individus entassés les
uns sur les autres. Ils mesurent entre 60 cm et 1 m de long et sont de
couleur noir suie afin de se confondre avec les roches basaltiques et d'
échapper ainsi à leurs prédateurs. Cette couleur leur
permet en outre de capter un maximum de chaleur. L’iguane passe d’ailleurs
le plus clair de son temps à se dorer au soleil. Lorsqu’il a trop
chaud, il se dresse sur les pattes avant pour faire circuler l’air sous
son ventre.
Seul lézard marin du monde, l’iguane
des Galapagos est présent sur toutes les côtes rocheuses de
l’archipel. Ils se rassemblent en hordes d’individus entassés les
uns sur les autres. Ils mesurent entre 60 cm et 1 m de long et sont de
couleur noir suie afin de se confondre avec les roches basaltiques et d'
échapper ainsi à leurs prédateurs. Cette couleur leur
permet en outre de capter un maximum de chaleur. L’iguane passe d’ailleurs
le plus clair de son temps à se dorer au soleil. Lorsqu’il a trop
chaud, il se dresse sur les pattes avant pour faire circuler l’air sous
son ventre.  La
température de leur corps varie entre 24° et 40°. On
les voit souvent cracher. Il s’agit en réalité pour eux de
rejeter un excès de sel ou d’intimider un adversaire.
Ils ont une espérance de vie d’environ
25 – 30 ans. Pendant la saison
des amours, le mâle prend parfois une couleur rouge et une raie de
couleur verte apparaît au milieu du dos, sur les avant-bras et les
pattes arrières.
La
température de leur corps varie entre 24° et 40°. On
les voit souvent cracher. Il s’agit en réalité pour eux de
rejeter un excès de sel ou d’intimider un adversaire.
Ils ont une espérance de vie d’environ
25 – 30 ans. Pendant la saison
des amours, le mâle prend parfois une couleur rouge et une raie de
couleur verte apparaît au milieu du dos, sur les avant-bras et les
pattes arrières.  Il en existe deux espèces particulières.
L’iguane terrestre se distingue de ses ancêtres par son absence totale
de crainte de l’homme. Il mesure entre 1m et 1.20m et pèse entre
3 et 7 Kg. Il peut vivre jusqu’à 70 ans. La
température de leur corps varie entre 34° et 36°.
Contrairement à leurs collègues
marins, ils vivent en petites colonies de quelques individus seulement.
Il en existe deux espèces particulières.
L’iguane terrestre se distingue de ses ancêtres par son absence totale
de crainte de l’homme. Il mesure entre 1m et 1.20m et pèse entre
3 et 7 Kg. Il peut vivre jusqu’à 70 ans. La
température de leur corps varie entre 34° et 36°.
Contrairement à leurs collègues
marins, ils vivent en petites colonies de quelques individus seulement.
 Il
existe une relation symbiotique amusante entre l’iguane terrestre et le
pinson de terre à petit bec, qui débarrasse le reptile de
ses tiques. A l’approche du pinson, l’iguane se redresse sur ses quatre
pattes, offrant au pinson le maximum de manoeuvrabilité pour faire
sa toilette. Depuis 1976, suite
à l’attaque par des chiens sauvages, le parc National à mis
en place un programme de protection et de conservation de l’espèce.
Des œufs ont été amené à la station Darwin
pour y être incubés et le jeunes iguanes sont élevés
en captivité. Actuellement ces iguanes sont replacés dans
différentes îles, la phase de repeuplement a donc commencé.
Il
existe une relation symbiotique amusante entre l’iguane terrestre et le
pinson de terre à petit bec, qui débarrasse le reptile de
ses tiques. A l’approche du pinson, l’iguane se redresse sur ses quatre
pattes, offrant au pinson le maximum de manoeuvrabilité pour faire
sa toilette. Depuis 1976, suite
à l’attaque par des chiens sauvages, le parc National à mis
en place un programme de protection et de conservation de l’espèce.
Des œufs ont été amené à la station Darwin
pour y être incubés et le jeunes iguanes sont élevés
en captivité. Actuellement ces iguanes sont replacés dans
différentes îles, la phase de repeuplement a donc commencé.  Deux groupes d’îles au monde possèdent
des tortues géantes. L’île d’Aldabara aus Seychelles, et l’archipel
des Galapagos. Les tortues sont arrivées en flottant depuis l’Amérique
du sud mais on ne sait pas si elles avaient à ce moment la taille
impressionnante d’aujourd’hui. Elles peuvent en effet peser jusqu’à
250 Kg pour les mâles et 50 Kg pour les femelles. Dans le passé,
elles étaient environ 25.000 dans l’archipel mais il n’en reste
qu’environ 2.000 aujourd’hui. C’est l’homme qui, pendant les 4 derniers
siècles, a décimé l’espèce. Certaines sous-espèces
ont pratiquement disparu. Le Parc National a même offert des primes
de 1000 $ à tous ceux qui trouveraient des femelles de ces espèces,
sans grand résultat.
Deux groupes d’îles au monde possèdent
des tortues géantes. L’île d’Aldabara aus Seychelles, et l’archipel
des Galapagos. Les tortues sont arrivées en flottant depuis l’Amérique
du sud mais on ne sait pas si elles avaient à ce moment la taille
impressionnante d’aujourd’hui. Elles peuvent en effet peser jusqu’à
250 Kg pour les mâles et 50 Kg pour les femelles. Dans le passé,
elles étaient environ 25.000 dans l’archipel mais il n’en reste
qu’environ 2.000 aujourd’hui. C’est l’homme qui, pendant les 4 derniers
siècles, a décimé l’espèce. Certaines sous-espèces
ont pratiquement disparu. Le Parc National a même offert des primes
de 1000 $ à tous ceux qui trouveraient des femelles de ces espèces,
sans grand résultat.
 Quand
elles sont menacées, leur premier reflexe et de rétracter
tête et membres sous leur carapace en poussant un sifflet strident.
Quand
elles sont menacées, leur premier reflexe et de rétracter
tête et membres sous leur carapace en poussant un sifflet strident.
 La
grande frégate a fréquemment recours au " clepto-parasitisme
". Ce mot compliqué signifie simplement qu’elle harasse sans arrêt
les autres oiseaux et en particulier le fou pour lui prendre sa nourriture
en vol. Elle est également capable d’attraper les poissons à
la surface de l’eau d’un simple coup de bec. Les
mâles ont un ramage noir avec un lustre bleu vert. Les ailes sont
longues et pointues et leur queue est fourchue. Pendant la saison des amours
(juste au moment où nous étions là), le mâle
gonfle une énorme poche rouge sous la gorge en vue d’attirer une
femelle sur un nid. Les femelles ont également un plumage noir mais
leur gorge ainsi que la partie supérieure de leur corps abdominal
sont blanches.
La
grande frégate a fréquemment recours au " clepto-parasitisme
". Ce mot compliqué signifie simplement qu’elle harasse sans arrêt
les autres oiseaux et en particulier le fou pour lui prendre sa nourriture
en vol. Elle est également capable d’attraper les poissons à
la surface de l’eau d’un simple coup de bec. Les
mâles ont un ramage noir avec un lustre bleu vert. Les ailes sont
longues et pointues et leur queue est fourchue. Pendant la saison des amours
(juste au moment où nous étions là), le mâle
gonfle une énorme poche rouge sous la gorge en vue d’attirer une
femelle sur un nid. Les femelles ont également un plumage noir mais
leur gorge ainsi que la partie supérieure de leur corps abdominal
sont blanches.  Il
en existe trois espèces dans l’archipel : le fou à pattes
bleues, le fou à pattes rouges et le fou masqué. Leur technique
de pêche est très spectaculaire : Lorsqu’ils repèrent
un poisson en vol, ils se laissent tomber comme des flèches de plus
de quinze mètres et fondent sur leur proie, leur laissant très
peu de chance d’en réchapper.
Il
en existe trois espèces dans l’archipel : le fou à pattes
bleues, le fou à pattes rouges et le fou masqué. Leur technique
de pêche est très spectaculaire : Lorsqu’ils repèrent
un poisson en vol, ils se laissent tomber comme des flèches de plus
de quinze mètres et fondent sur leur proie, leur laissant très
peu de chance d’en réchapper.  Abondantes
dans l’archipel, les otaries se réunissent en colonies sur le sable
ou sur les rochers. Le mâle est polygame mais il n’existe pas de
harem à proprement parler car la femelle et libre d’aller et venir.
Le mâle se distingue de la femelle par sa taille énorme et
par une bosse frontale . Le mâle est adulte à partir de 10
ans et pèse jusqu’à 250 Kg. La femelle est adulte vers 6-8
ans et pèse environ 120 Kg.
Abondantes
dans l’archipel, les otaries se réunissent en colonies sur le sable
ou sur les rochers. Le mâle est polygame mais il n’existe pas de
harem à proprement parler car la femelle et libre d’aller et venir.
Le mâle se distingue de la femelle par sa taille énorme et
par une bosse frontale . Le mâle est adulte à partir de 10
ans et pèse jusqu’à 250 Kg. La femelle est adulte vers 6-8
ans et pèse environ 120 Kg.  Il existe une variété particulière
d’otaries, les otaries à fourrure, plus petite, au nez pointu et
au regard un peu triste, que les gens prennent souvent pour des phoques.
Or, il n’y a pas de phoque aux Galapagos.
Il existe une variété particulière
d’otaries, les otaries à fourrure, plus petite, au nez pointu et
au regard un peu triste, que les gens prennent souvent pour des phoques.
Or, il n’y a pas de phoque aux Galapagos.
 Les
différences entre ces otaries et les phoques sont nombreuses : les
phoques n’ont pas d’oreille externe, ils ne peuvent se maintenir sur leurs
nageoires avant et restent aplatis sur le sol. En outre, ils se déplacent
dans l’eau avec leurs nageoires postérieures. Elles furent près
de l’extinction au début de notre siècle suite au ravage
des baleiniers et chasseurs de peaux.
Les
différences entre ces otaries et les phoques sont nombreuses : les
phoques n’ont pas d’oreille externe, ils ne peuvent se maintenir sur leurs
nageoires avant et restent aplatis sur le sol. En outre, ils se déplacent
dans l’eau avec leurs nageoires postérieures. Elles furent près
de l’extinction au début de notre siècle suite au ravage
des baleiniers et chasseurs de peaux.