|
Situation géographique |
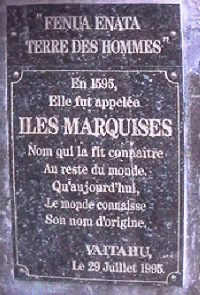 |
|
Situation géographique |
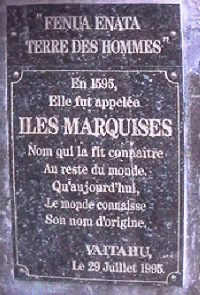 |
 Situé
en plein océan Pacifique, l’archipel des Marquises est constitué
par un groupe de 10 îles et quelques îlots comprises entre
7°55’ et 10°33’de latitude sud et 138°35’et 140°43’ de
longitude ouest. Les îles s’étirent du Nord-Ouest au
Sud-Est. Seules six d’entre elles sont aujourd’hui habitées.
Elles sont très isolées, et la distance a limité les
échanges entre les îles elles-mêmes, qui ont chacune
leur personnalité. Toutes d’origine
volcanique, elles sont très impressionnantes : blocs de laves surgit
de l’océan, culminant à plus de 1000 mètres, dentelés
et déchiquetés, couverts des milles verts d’une végétation
très dense. Les qualificatifs utilisé pour qualifier
la nature de ces îles convient aussi à leur habitants
: rudes, authentiques. Situé
en plein océan Pacifique, l’archipel des Marquises est constitué
par un groupe de 10 îles et quelques îlots comprises entre
7°55’ et 10°33’de latitude sud et 138°35’et 140°43’ de
longitude ouest. Les îles s’étirent du Nord-Ouest au
Sud-Est. Seules six d’entre elles sont aujourd’hui habitées.
Elles sont très isolées, et la distance a limité les
échanges entre les îles elles-mêmes, qui ont chacune
leur personnalité. Toutes d’origine
volcanique, elles sont très impressionnantes : blocs de laves surgit
de l’océan, culminant à plus de 1000 mètres, dentelés
et déchiquetés, couverts des milles verts d’une végétation
très dense. Les qualificatifs utilisé pour qualifier
la nature de ces îles convient aussi à leur habitants
: rudes, authentiques.
[retour] |
| Genèse
Haakakai OTe Fenua Enata- La légende
des îles marquises
Une légende raconte sur un mode allégorique
la genèse des îles Marquises :
Au commencement du monde, deux divinités , Oatea et Atuana régnaient sur l’immense océan. Un jour Atuana émit le vœu de vivre dans une maison. Oatea promit à son épouse d’achever la maison avant le lendemain à l’aube. Il fit appel à ses pouvoirs divins ; il choisit un emplacement dans l’océan pour la future maison. Il dressa deux piliers, et dit « voici Ua Pou ». Il prit ensuite une poutre faîtière, la posa sur les deux piliers, l’attacha avec de la fibre de coco et dit « voici Hiva Oa ». Après avoir installé les chevrons, il dit « voici Nuku Hiva » (la charpente). Puis il confectionna la couverture de la maison avec neuf palmes de cocotier et dit « voici Fatu Hiva » (le toit). Il creusa un trou pour enfuir les végétaux dans le sol. Son travail presque achevé, Atuana vit l’aube à l’horizon. « c’est Tahuhata » dit Oatea. Et Atuana lui dit : « écoute l’oiseaux du matin qui chante », et Oatea répondit « c’est Mohotani ». Atuana acheva vite son travail en jetant les restes végétaux dans le trou et dit « voici Ua Huka » (la réserve). Et sentant ses pouvoirs divins le quitter avec l’arrivée du soleil, il dit « voici Eiao ». Ce mythe fondateur assimile la création
de l’archipel à la construction d’un Hae (maison). Il ne concerne
que les îles qui furent jadis habitées. Mohotani et
Eiao ne le sont plus.
Culture et organisation sociale Avant l’arrivée des européens, les Marquisiens avaient développé une culture se distinguant à plusieurs points de vue de la culture du reste de la Polynésie. Leur art est remarquable, un des plus développé et raffiné du Pacifique. Les très beaux tatouages témoignent encore de leur maîtrise. Ils décoraient le corps des guerriers, soulignant leur bravoure. Ils sculptaient aussi le bois et la pierre pour faire des tikis. La sculpture sur os était très développée également. Le tressage et la vannerie aussi. Et la confection de tapa, étoffes d’écorce battue décorées se perpétue encore. |
La culture marquisienne
à souffert de la colonisation européenne ; la langue et les
coutumes surtout. Les marquisiens, convertis au catholicisme, devaient
apprendre le français, et la langue véhiculaire était
le Tahitien. Les spécificités marquisiennes s’éteignaient…
Mais à la fin des années 70, sous l’impulsion d’un groupe
de marquisiens, et d’un évêque plus intelligent que les autres
(choqué d’entendre la messe qui l’accueillait dite en Tahitien,
langue étrangère), une entreprise de réhabilitation
de la culture traditionnelle marquisienne fut menée. Motu
Haka, association de promotion de la langue et du patrimoine marquisiens
fut créée à Ua Pou en 1978.
Etienne, que nous avons rencontré à Hakateau en est un des animateurs. Il s’occupe aujourd’hui plus particulièrement du comité de la langue marquisienne. Le but est de promouvoir l’enseignement de la langue, et de veiller à sa modernisation, pour qu’elle puisse être une langue utilitaire ; il faut sans cesse inventer des mots, comme télévision, voiture etc… Il faut aussi veiller à unifier les règles d’usages, qui diffèrent d’une île à l’autre. Ce mouvement fut précurseur ; il s’inscrit aujourd’hui dans une perspective plus large de revalorisation de la culture traditionnelle dans tout le Pacifique. Il a mené également à la redécouverte de nombreux sites archéologiques, et à leur restauration. Les marquises, sont à cet égard, d’une très grande richesse. On trouve de nombreux meae (appelé marae ailleurs en Polynésie), temple sacré en pierre, lieux de tous les événements importants de la cité. Enfin, ce mouvement de réhabilitation de la culture a permis aux Marquisiens de redécouvrir et d’assumer certains aspects de leur culture, jadis occulté par les missionnaires. Au premier plan de ceux-ci, le cannibalisme, part intégrante des rituels guerriers en vigueur dans les conflits qui opposaient les vallées l’une à l’autre. Les guerriers capturés ou mort au combat faisait office de victime propritiatoires. Les chefs et les guerriers pouvaient s’approprier le mana, l’esprit, de l’ennemi tué au combat. La pratique du cannibalisme fut officiellement abandonnée en 1867 (mais manifestement pratiquée jusqu’au début du XXè siècle). Les conflits étaient fréquents. La population était divisée en clan, groupé par vallée. Les vallées se faisaient la guerre. Au sein d’un clan régnait un chef (hakaiki). Des prêtres servaient d’intermédiaires entre les dieux et le clan. Un chef guerrier dirigeait les soldats. Le reste de la population constituait le meie, le peuple. |
Certaines conceptions traditionnelles marquent encore le comportement actuels des marquisiens. Par exemple, le don n’ayant comme objet que des produits de la nature, et ceux étant considéré comme une propriété collective, ce geste n’appellait pas une reconnaissance particulière. Le mot « merci » n’existait pas en marquisien. Et aujourd’hui, quand un Marquisien vous donne quelque chose, il reste surpris par vos démonstrations de reconnaissance. Il n’attend rien, donne sans attendre de retour. On apprend beaucoup à leur contact[retour] On distingue généralement deux
groupes, les Marquises du Nord et les Marquises du Sud. Elles ne
furent pas découvertes par les Européens au même moment.
Après ce premier contact sanglant, les Marquises allaient être préservée pendant deux siècles. En 1774, Cook revisitera les Marquises Sud, abordant à Tahuata. Et c’est seulement en 1791 que les Marquises nord (Nuku Hiva) furent abordées par deux navigateurs : l’américain Ingraham le premier, et le français Marchand quelques mois plus tard. Après cela, les visites se firent plus régulières, pour le plus grand malheur des marquisiens. Les maladies européennes, l’alcool et les armes à feu allaient réduire la population. Pire, malgré le « protectorat » établi par la France en 1842, des marchands d’esclaves péruviens raflèrent la population mâle de l’île pour l’emmener travailler dans les plantations et dans les mines en 1863. Quand, après des protestations diplomatiques, les péruviens ramenèrent les très rares survivants, ils rapportèrent une épidémie de variole qui acheva de décimer la population. Celle-ci n’est jamais remontée au niveau qu’elle connaissait à l’arrivée de Cook, qui estime à plus de 50.000 la population de l’archipel. En 1926, il n’y avait plus que 2000 habitants aux Marquises. Aujourd’hui, ils sont environ 7.000 à 8.000. [retour] |
Visiteurs
célèbres

|
Les Marquises ont reçu plusieurs visiteurs célèbres : Herman Melville arriva à Nuku Hiva à bord d’un baleinier, Robert Louis Stenvenson sur son voilier, Casco. Plus tard, Gauguin devait vivre à Hiva Oa plusieurs années. Et c’est sur la même île que, bien plus tard, Jacques Brel devait choisir d’interrompre son voyage en bateau pour s’établir. Ils sont tous les deux enterrés dans le cimetière d’Atuona.[retour] |
| HIVA
OA,LA POUTRE MAITRESSE
Longtemps capitale administrative de l’archipel,
Hiva Oa est sans doute la plus connue des îles Marquises, notamment
grâce aux deux visiteurs mentionnés ci-dessus.
C’est la plus grande île du groupe sud. L’île compte
de nombreux sites archéologiques ; à Taaoa, nous avons visité
ce qui est « le machu pichu » des Marquises. Ce site
serait le plus grand de Polynésie, mais n’est pas entièrement
dégagé de la végétation qui l’a envahit.
Perché dans le fond de la vallée, où se trouvaient
toujours les villages dans la civilisation traditionnelle, il est très
impressionnant.
|

A Atuona, ville principale de l’île de l’île, nous avons proposé à la classe de CM1-A- (aujourd’hui CM2) du collège d’Atuona de Marie Elisabeth Vaatete un jumelage avec la quatrième primaire (aujourd’hui cinquième) de Franca à Decroly. Et les plus grands du GOD d’Atuona, déjà en vacance, ont cependant reçu les adresses des écoles secondaires qui nous suivent, Decroly à Uccle et Pierre Paulus à Saint-Gilles. Nous avons visité aussi le cimetière, perché sur la colline, face à la baie, et à l’île de Tahuata.[retour] |
| TAHUATA,
L’AURORE 
|
La plus petite des îles habitée
de l’archipel est séparée de Hiva Oa de quelque milles.
Ses plages de sables blancs, les seules de l’archipel, ont vu débarquer
les premiers européens. L’amiral Dupetit-Thouars y signa le
traité de rattachement à la France en 1842. Les habitants
de Tahuata cultivent le coprha, et sont se sont spécialisés
dans un type d’artisanat : la sculpture sur os.
[retour] |
| UA
POU, LES PILIERS
C’est l’île la plus peuplée de l’archipel. Elle est à la fois jeune et ancienne, car sa géomorphologie a pour origine deux périodes différentes d’activités volcaniques. Au centre de l’île se dressent d’énormes pics, incroyablement dentelés et pointus. Les géologues nomment « necks » ces sortes d’obélisques basaltiques dressées vers le ciel. Quand les nuages se lévent, c’est un spectacle incroyable. Hakahau est la capitale de l’île. On y trouve un grand lycée. Nous avons préféré le petit village d’Hakateau [retour] |
 |
| NUKU
HIVA, LA CHARPENTE
C’est la plus grande île de l’archipel, la deuxième de Polynésie. Elle abrite la capitale administrative, Taiohae, au fond d’une grande gaie, superbe, plus ouverte que les autres baies dans les autres îles. L’île est formée par deux volcanx, qui ont donné deux caldeiras concentriques Ses paysages sont spectaculaires, parfois moins verts que les îles du Sud, mais fascinants. A Hakaui se trouve une des plus hautes cascades du monde, 350 mètres de chutes verticales. Melville et Stevenson séjournèrent sur Nuku Hiva. Melville y situe son roman Tapaï, qui relate son expèrience de vie dans un petit village isolé (1846). Stenvenson a mouillé son bateau devant le petit village d’Anaho en 1888. La vie à Nuku Hiva est malheureusement gâchée par le nono, petite mouchette qui inflige des piqûres d’abord indolores mais très démangeantes. [retour] |
UA
HUKA, LA RESERVE
Nous n’avons pas visité Ua Huka, un
peu à l’écart de notre route. C’est paraît-il
une île plus désertique, où paissent de très
nombreux chevaux, et des chèvres.
|