Le climat est tropical. Il y a en moyenne 25-30 degrés centigrades, mais il fait très humide. Il y a deux saisons très marquées : la saison sèche, de fin décembre à fin avril, et la saison des pluies, de mai à la fin de l'année. Les pluies sont les plus importantes au mois de juillet et d'août. Ce doit être vraiment le déluge, vu ce que nous subissons en ce début de saison des pluies...
Cette pluie permet le développement d'une végétation intense, et tous les lieux que l'homme n'occupe pas sont envahis par la forêt tropicale. Cette forêt est très riche en espèce végétale et animale : plus de 900 espèces d'oiseaux, 1500 arbres différents, et plus de 10 000 plantes.
La population est très métissée. Il y a bien sûr des indiens, qui vivent encore souvent en communautés unies. Ils ont une importance certaine dans la société panaméenne, plus que dans de nombreux pays sud-américains. Certaines tribus, telle les Kunas, bénéficient d'une certaine autonomie institutionnelle.
L'autre influence essentielle est occidentale. Les premiers colons espagnols, les français du canal au XIXè, les américains depuis, ont laissé de nombreux descendants, parfois métissés avec des indiens ou des africains. Car il y a aussi des noirs et des asiatiques. Les premiers africains ont été emmenés comme esclaves par les espagnols dès le XVIè siècle. Quelque siècles plus tard, asiatiques et africains sont arrivés comme main d'oeuvre pour le canal (depuis les territoires français des antilles pour les africains et essentiellement de Chine pour les asiatiques). Une nouvelle vague d'immigration asiatique paraît s'être développée ces dernières années, en relation avec le commerce (les asiatiques maîtrisent déjà le commerce de détail dans tout l'océan Pacifique, et ils s'implantent de plus en plus en Amérique centrale).
Les panaméens parlent l'espagnol, mais beaucoup d'entre eux maîtrisent l'anglais. Les noirs venu de Jamaïque ou des antilles françaises parlent encore parfois des dialectes rappelant le créole "francophone" ou l'anglais "jamaïcain".
La monnaie est le "balboa", qui est équivalent à un dollars US. On utilise d'ailleurs la monnaie américaine. Il n'y a pas de billet en balboa, seulement de la monnaie.
Eléments d'histoire
Avant la colonisation
Les premiers vestiges de présence
humaine trouvés au Panama ont été estimés vieux
de 11.000 ans.
Les archéologues estiment que depuis
5.000 ans avant J.C., le Panama est divisé en trois régions
culturelles disctinctes, qui ont subsisté jusqu'à l'arrivée
des espagnols au XVIè siécle. Ces trois régions
(Est, Centrale et Ouest) n'étaient pas isolées; elles avaient
des relations entre elles, et avec les royaumes d'Amérique centrale
et du Mexique.
La région Ouest a été
le siège d'une civilisation connue pour ses statues de pierre et
ses poteries en céramique monochrome nommée "bugaba", civilisation
qui semble s'être éteinte après l'éruption du
volcan Barù au 5è siècle.
La région centrale est connue pour
ses céramiques portant des réprésentations zoomorphiques,
c'est-à-dire des animaux stylisés, comme des alligators,
des jaguars, des crabes... On a retrouvé des dizianes de ces
céramiques sur un site de cérémonie très important,
Sitio Conte. Plus les poteries sont récentes, plus les figures
sont abstraites et géométriques.
La région occidentale est la moins
bien connue. Comme dans d'autres parties d'Amérique centrale, l'or
était traité, et utilisé comme instrument d'échange,
mais avait aussi un rôle symbolique important, indiquant notamment
le statut social et l'identité de celui qui le portait.
Ce n'est pas Colomb qui découvrit
le Panama. Mais c'est lui qui comprit l'importance que pouvait avoir
l'isthme. Lors de son quatrième voyage, en automne 1502, des
indiens lui parlèrent d'une immense étendue d'eau et de mine
d'or à quelques journées de marche. Les espagnols entamèrent
alors la colonisation dans ce qui est aujourd'hui la province du Darién.
En 1510, une ville est fondée. En 1513, Vasco Nunez de Balboa
traversa le Darién et découvrit "la mer du sud". Le
roi d'Espagne comprit l'importance de la découverte, et envoya de
nombreuses troupes.
Mais la colonisation allait se heurter aux
conditions climatiques difficiles; la maladie allait faire des ravages
dans les rangs espagnols. Cependant, en 1519, la ville de Panama
(devenue Old Panama) était fondée sur la côte Pacifique.
Panama allait prendre une importance considérable
dans le processus de colonisation et de conquête espagnol : c'est
de là que Pizzaro part pour conquérir le Pérou; c'est
par Panama que transiteront toutes les richesses d'Amérique centrale
en route pour l'espagne.
Panama connaît une période
d'opulence pendant deux siècles. La richesse de ces contrées
attirent les pirates et les boucaniers. Francis Drake détruisit
la ville de Nombre de Dios en 1596, mais fut arreté sur la route
de Panama.
En 1668, le pirate Henry Morgan prit Portobello,
et trois ans plus tard, il conquit Panama.
Suite à ce désastre, les espagnols
décidérent de déménager la ville en un endroit
moins vulnérable. La nouvelle Panama fut fondée en
1673 sur la péninsule d'où elle déborde aujourd'hui
largement.
Les espagnols mettront du temps à
exploiter les richesses du pays lui-même. Les régions
aurifères sont occupées par des tribus indiennes qui défendront
farouchement leur territoire. De plus, les colonisateurs devront
faire face à des révoltes d'esclaves, dont certains prendront
le maquis dans la jungle et attaqueront les convois traversant le pays.
A la fin du XVIè, les soldats espagnols devront même faire
face à une alliance entre indiens, esclaves rebelles et pirates
anglais et britanniques !
La terre elle-même ne rapporte pas
beaucoup au Panama, c'est le commerce qui est rémunérateur.
Or, la noblesse espagnole ne considère pas le commerce comme une
manière digne de s'enrichir. C'est donc essentiellement la
bourgeoisie espagnole, les commerçants, qui forment l'essentiel
de la population coloniale. Celle-ci ne partagent pas toujours
les intérêts de la couronne. Les bourgeois exigeront
d'être représentés dans la gestion des villes, au sein
du "cabildo" (gouvernement de la communauté urbaine), et s'opposent
de plus en plus souvent à la couronne. Quand l'économie
panaméenne décline, au XVIIIè siècle (notamment
parce que les routes commerciales maritimes abandonnent l'amérique
centrale, qui oblige un convoyage terrestre, au profit de la route du Cap
Horn), les bourgeois panaméens songent à prendre leur destin
en main.
Le début du XIXè siècle
est marqué par l'indépendance progressive de tout l'Amérique
latine. Le Vénézuela et la Colombie se déclarent
indépendants en 1811, et en 1824, Bolivar le libérateur remporte
sa dernière victoire sur les espagnols. En 1821, le 28 novembre,
le Panama se déclare indépendant, et rejoint la grande Colombie,
qui réunit déjà la Colombie, le Vénézuela
et l'Equateur, embryon du rêve de Bolivar d'une Amérique latine
unie.
En septembre 1830, le Panama se sépare
de la Colombie. Il s'ensuit une longue série de mariage-divorce,
lié notamment à l'influence des courants conservateur et
libéral au Panama. La Colombie est dirigée par des
conservateurs; les bourgeois panaméens sont libéraux, attachés
à la liberté de commerce. Quand ils sont puissants,
ils se séparent de la Colombie conservatrice, quand ils perdent
de leur influence, c'est la réunion. Cette valse-hésitation
dure pendant tout le XIXè siècle, jusqu'en 1903, où
elle prend fin définitivement, plutôt en raison d'intérêts
géostratégiques américains, que d'un changement interne
au pays.
Historique
L'idée de construire un canal entre
les deux océans à travers l'isthme d'Amérique centrale
est très ancienne. En 1534, déjà, le roi d'Espagne
Charles Ier fait réaliser une étude sur la possibilité
de concrétiser cette idée. Les bateaux espagnols se
servaient à l'époque des rivières panamaméennes
pour raccourcir le trajet entre les deux océans pour transporter
l'or arraché au Pérou. Mais ils ne pouvaient
franchir par ce moyen la cordillère panaméenne, partie du
massif montagneux qui traverse les continents américains.
Trois siècles plus tard, en 1880,
les français entament la percée du canal, sous la direction
du célèbre Ferdinand de Lesseps, qui vient de diriger la
construction de canal de Suez. Mais les obstacles à surmonter
sont énormes; les français n'en viendront pas à bout.
La jungle et le climat tropical imposent des conditions sanitaires qui
causeront épidémies de fièvre et de malaria, une des
causes de l'échec français. S'y ajoutent des
problèmes financiers importants, qui seront à la base, en
France, d'une crise politique grave quand on découvrira des actes
de corruption à large échelle au sein de la classe politique.
Enfin, l'idée de Lesseps de réaliser un canal transocéanique
au niveau de la mer apparaîtra bientôt comme irréalisable.
Neuf ans plus tard, les français renoncent.
Dès lors, les américains vont
tout faire pour obtenir le droit de creuser un canal à travers l'isthme.
En 1902, un traité négocié entre le gouvernement colombien
(dont fait partie le Panama à ce moment) et le gouvernement américain
est rejetté par le parlement colombien parce que considéré
comme portant atteinte à la souveraineté nationale et ne
garantissant pas des revenus suffisants au pays.
Les Etats-Unis vont alors soutenir, si pas
provoquer, l'indépendance du Panama. Le Panama déclare
son indépendance sous la protection des navires de la US navy.
Quinze jours plus tard, le Panama et les Etats-unis signent le traité
Hay-Bunau Varilla aux termes duquel les Etats-Unis entreprennent la construction
d'un canal transocéanique, et se voient accorder la possibilité
d'exercer "les mêmes droits, pouvoirs et autorités que s'ils
étaient un état souverain". En 1904, ils rachètent
les droits et propriétés françaises.
Les ingénieurs, travaillant sous
la direction du Colonel G.W. Goethals (sans doute un descendant d'ancêtres
de chez nous ou d'outre-moerdijk...), devront résoudre des problèmes
considérables : franchir le "continental divide", la ligne de partage
des eaux, qui sépare les eaux s'écoulant vers le Pacifique,
à l'Ouest, de celles s'écoulant vers l'Atlantique, à
l'Est; construire le plus grand barrage jamais réalisé à
l'époque; conçevoir les plus grandes écluses du monde,
avec les plus grandes portes existantes etc...
Il faudra aussi aux responsables des travaux
résoudre les problèmes sanitaires qui ont arrêtés
les français. Un travail énorme d'assainissement du
site sera accompli.
Il faudra 10 ans pour achever le travail.
Le 15 août 1914, alors que la guerre fait rage en Europe, le premier
bateau transite par le Canal de Panama.
D'après le traité, les Américains
recevaient à perpétuité la maîtrise du canal,
et de la zone géographique le bordant. Ils avaient le droit
de maintenir des troupes militaires pour surveiller le canal et d'intervenir
militairement pour "préserver l'ordre constitutionnel". Ils
assuraient eux-mêmes la gestion, et la maintenance du canal en toute
indépendance.
Cette omniprésence américaine
fut parfois mal ressentie par la population; des troubles violents ont
éclatés notamment en 1959 et 1964.
Depuis, le traité initial a été
amendé, puis un nouveau traité a été
signé (Torrijos-Carter, en 1977). Un processus de rétrocession
du canal au Panama a été engagé. Il passe par
une période de gestion commune, entrée en vigueur en 1979,
et doit s'achever le 31 décembre 1999. Ce jour là,
les panamaméens reçevront la pleine et entière propriété
du canal, et la responsabilité -très lourde - de gérer
et d'assurer la maintenance de ce "carrefour des océans", encore
essentiel pour le commerce mondial.
Caractéristiques
et description du
passage
Le canal de Panama est long de 83, 5 kilomètres
(45 miles nautiques), depuis les eaux de l'Atlantique jusqu'au eaux du
Pacifique.
Venant
de l'Altantique, un navire franchi d'abord les énormes brises-lames
qui protègent la baie de Colòn et le port de Cristobal.
S'il franchit le canal pour la première
fois, il doit être mesuré et jaugé selon les normes
-propres au canal- qui permettent de calculer son droit de passage.
Il reçoit alors un numéro d'idenfication, qui accompagnera
le bateau tout au long de sa vie, et qui évitera des mesurages ultérieurs.
Un jour de passage lui est attribué.
Ce jour là, un pilote se rend à son bord pour assister le
capitaine du bateau pour le passage. Ces démarches sont les
mêmes pour les petits bateaux de plaisance, si ce n'est que leur
temps d'attente est souvent plus long que des cargos, car ils constituent
"une quantité négligeable" pour le canal, et qu'on les "glisse"
dans une écluse quand il y a de la place.
Le bateau se dirige ensuite à
travers un chenal, dragué et entretenu en permanence, vers le premier
groupe d'écluses, les écluses de Gatun.
 Il y a trois écluses succesives, qui assurent la montée du
bateau de presque 26 mètres jusqu'au lac de Gatun (la hauteur exacte
dépend du niveau du lac de Gatun, qui dépend des précipitations).
Chaque chambre d'écluse est large de 33,53 mètres, et longue
de 304,8 mètres. La longueur totale des écluses de
Gatun, incluant les deux murs d'approches, est de 1,9 kilomètres
de long.
Il y a trois écluses succesives, qui assurent la montée du
bateau de presque 26 mètres jusqu'au lac de Gatun (la hauteur exacte
dépend du niveau du lac de Gatun, qui dépend des précipitations).
Chaque chambre d'écluse est large de 33,53 mètres, et longue
de 304,8 mètres. La longueur totale des écluses de
Gatun, incluant les deux murs d'approches, est de 1,9 kilomètres
de long.
 Les
gros bateaux peuvent être aidé d'un ou plusieurs remorqueurs
s'ils ne sont pas très manoeuvrant.
Les
gros bateaux peuvent être aidé d'un ou plusieurs remorqueurs
s'ils ne sont pas très manoeuvrant.

 Dans l'écluse, ils sont tractés par des locomotives, appellées
des "mules" qui les accompagent sur toute la longueur, et qui les maintiennent
au centre de l'écluse. Il y a au moins quatre locos par bateau
(il peut en avoir jusqu'à huit), deux de chaque côtés,
qui reçoivent chacune une aussière. Chaque "mules"
pèsent 55 tonnes et est équipée de deux treuils produisant
chacun plus de 17.000 kilos de tractions.
Dans l'écluse, ils sont tractés par des locomotives, appellées
des "mules" qui les accompagent sur toute la longueur, et qui les maintiennent
au centre de l'écluse. Il y a au moins quatre locos par bateau
(il peut en avoir jusqu'à huit), deux de chaque côtés,
qui reçoivent chacune une aussière. Chaque "mules"
pèsent 55 tonnes et est équipée de deux treuils produisant
chacun plus de 17.000 kilos de tractions.
Les plus petits bateaux n'ont bien sûr
pas besoin d'une telle puissance; ils sont suivis par des hommes qui tiennent
l'aussière à la main, tandis que le bateau se déplace
d'écluse en écluse avec son moteur. Quand l'écluse
se remplit, ils mettent l'aussière sur une bite d'ammarage, et c'est
l'équipage du bateau qui reprend le mou dû à la montée
du bateau dans l'écluse. C'est pour cela que chaque petit
bateau doit avoir pour équipage, en plus du barreur et du pilote
du canal, quatre "line-handlers", les "teneurs d'aussières".
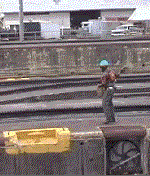 Pour attraper la grosse aussière, les hommes du canal lancent sur
le bateau, depuis les bords de l'écluse, une "touline", petit bout
s'achevant par une grosse boule enroulée de corde. L'équipier
fixe ensuite l'aussière sur la touline, et l'homme la reprend.
Pour attraper la grosse aussière, les hommes du canal lancent sur
le bateau, depuis les bords de l'écluse, une "touline", petit bout
s'achevant par une grosse boule enroulée de corde. L'équipier
fixe ensuite l'aussière sur la touline, et l'homme la reprend.
Les gros bateaux passent bien sûr un par un dans les écluses, parfois accompagnés de leur(s) remorqueur(s), détachés d'eux à ce moment. Mais les voiliers et les petits bateaux de plaisance passent à plusieurs dans l'espace laissé libre devant ou derrière un gros cargo.
Plusieurs configurations sont possibles : soit le voilier est seul au milieu de l'écluse, où il se maintient grâce à ses quatres aussières; soit il est à couple d'un ou de deux bateaux, et le bloc qu'ils forment ensemble, maintenu par des bouts, est maitenu au centre de l'écluse par les équipiers qui se trouvent à l'extrémité du "bloc", c'est-à-dire à l'avant et à l'arrière des bateaux de droite et de gauche. Mais le bateau peut aussi passer le long de la paroi de l'écluse, ce que les skipper n'aiment pas parce que cette paroi est pleine d'aspérités qui n'inquiètent pas la coque en acier d'un tanker de 150.000 tonnes, mais qui déchireraient facilement la petite coque polyester de nos bateaux. Enfin, position la plus confortable, il arrive que des voiliers passent à couple des remorqueurs. Ils sont alors attachés à eux, et ne font rien d'autres que lancer et récupérer les bouts qui assurent ce lien.
Vous
lirez ou avez lu qu'Ataram a passé les premières écluses
au milieu de deux bateaux, et qu'il est redescendu à couple d'un
autre.
 Quand les bateaux sont dans l'écluse, bien fixé par leurs
aussières, les énormes portes en métal se referment,
et l'eau commence à jaillir des vannes situées sous l'écluse.
Quand les bateaux sont dans l'écluse, bien fixé par leurs
aussières, les énormes portes en métal se referment,
et l'eau commence à jaillir des vannes situées sous l'écluse.
Les portes mesurent entre 16 et 28
mètres de haut, sont épaisses de plus de deux mètres
et pèsent entre 400 et 700 tonnes. Elles peuvent être
ouvertes ou fermées en deux minutes.
 La chambre de l'écluse est remplie en dix minutes. Pour chaque
passage de bateaux, c'est près de 200 millions de litres d'eau douce
qui se déverse dans les océans. Cette eau provient
de lacs artificiels, le lac Gatun et le lac Madden.
La chambre de l'écluse est remplie en dix minutes. Pour chaque
passage de bateaux, c'est près de 200 millions de litres d'eau douce
qui se déverse dans les océans. Cette eau provient
de lacs artificiels, le lac Gatun et le lac Madden.
Les portes avant de l'écluse s'ouvrent alors, et les bateaux s'ébranlent.
 Pour aider les locomotives, les cargos donnent un peu de moteur.
Cela crée des remous assez inquiétant à l'échelle
d'un voilier, quand on est derrière, et que l'on est poussé
en arrière, vers la porte.
Pour aider les locomotives, les cargos donnent un peu de moteur.
Cela crée des remous assez inquiétant à l'échelle
d'un voilier, quand on est derrière, et que l'on est poussé
en arrière, vers la porte.
Après les trois écluses, les
bateaux entrent sur le lac de Gatun. C'est une des plus grandes
étendues artficielles d'eau du monde (il couvre 423 kilomètres
carrés).  Il est formé par la rivière Chagres, arrêtée
par un énorme barrage, qui fournit l'énergie électrique
que nécessécite la canal.
Il est formé par la rivière Chagres, arrêtée
par un énorme barrage, qui fournit l'énergie électrique
que nécessécite la canal.
 Les bateaux parcourent 38 kilomètres sur ce lac, dont une partie
dans un canal étroit de 13 kilomètres de long, qui a exigé
des travaux d'excavations gigantesques, le gaillard cut, et qui fut le
lieu de l'échec français. La jungle couvrent toutes les
berges, et en certains endroits, des troncs morts émergent de l'eau.
Les bateaux parcourent 38 kilomètres sur ce lac, dont une partie
dans un canal étroit de 13 kilomètres de long, qui a exigé
des travaux d'excavations gigantesques, le gaillard cut, et qui fut le
lieu de l'échec français. La jungle couvrent toutes les
berges, et en certains endroits, des troncs morts émergent de l'eau.
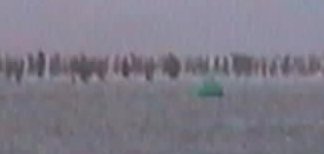
Le passage du canal se fait normalement en 9 heures, mais il est courant que les voiliers soient contraints de passer la nuit sur le lac Gatun. C'est ce qui nous est arrivé lorsque nous passions avec "Voyou" .
Aujourd'hui encore, des travaux sont réalisés en permanence pour stabiliser les terres autour du canal et permettre son élargissement.
 De nombreuses collines qui entourent le canal ont été, et
sont encore "rabotées" par l'homme.
De nombreuses collines qui entourent le canal ont été, et
sont encore "rabotées" par l'homme.

Au bout de cet impressionnant passage, les
bateaux atteignent la deuxième série d'écluses, les
premières descendantes : les écluses de Pedro Miguel.
 En une seule "descente" de 9,45 mètres, ces écluses longues
de 1,3 kilomètres permettent l'accès au lac de Miraflorès,
petite étendue d'eau de 1,6 kilomètres de long. Un
yacht-club y est installé.
En une seule "descente" de 9,45 mètres, ces écluses longues
de 1,3 kilomètres permettent l'accès au lac de Miraflorès,
petite étendue d'eau de 1,6 kilomètres de long. Un
yacht-club y est installé.
Au bout de ce lac, la dernière série d'écluses, les écluses de Miraflorès.
 En deux étapes, les écluses mènent
au Pacifique. Leurs portes sont les plus hautes de tout le système,
vu les importantes variations de niveau du Pacifique, dû aux marées.
En deux étapes, les écluses mènent
au Pacifique. Leurs portes sont les plus hautes de tout le système,
vu les importantes variations de niveau du Pacifique, dû aux marées.

Le pont des Amériques enjambe le
canal au dessus du port de Balboa.
 Les bateaux passent en dessous pour se rendre directement vers le Pacifique,
ou dans la zone de mouillage du Pacique, ou, pour les voiliers, au
Balboa Yacht Club.
Les bateaux passent en dessous pour se rendre directement vers le Pacifique,
ou dans la zone de mouillage du Pacique, ou, pour les voiliers, au
Balboa Yacht Club.
Les
villes que nous avons vues : COLÒN-CRISTOBAL
Colòn-Cristobal est le port tropical tel qu'on le lit dans les romans de mer et d'aventures comme ceux de Conrad. Petite ville à l'allure coloniale, elle à l'air en décrépitude; mais on dit cela depuis plus de quarante ans, cela semble donc être comme un état permanent... La ville semble avoir deux coeurs, tous deux commerciaux : son port et sa zone libre. Le port s'est aggrandi dernièrement d'un énorme terminal pour conteneur. Tous les bateaux ne passent pas le canal; certains déchargent des cargaisons qui traversent Panama en train, ou qui sont destinées à l'Amérique centrale.
La zone libre est une zone commerciale où tout est vendu sans taxes, pour l'exportation. C'est paraît-il la plus grande zone libre du monde après Hong-Kong. C'est une ville dans la ville, crée en 1949, et qui attire des acheteurs depuis toute l'amérique latine.
La ville se nommait Cristobal Colòn en l'honneur du découvreur des Amériques. Mais quand les américains ont commencé le canal, avec le droit d'exercer leur juridiction sur la zone du canal, le port, devenu zone américaine, a été appelé Cristobal, tandis que la ville panaméenne se voyait nommée Colòn.
Vu sa position privilégiée, la ville a acceuilli des hôtes prestigieux, de nombreux politiciens (le premier ministre anglais Lloyd Georges, les présidents américains Harding et Roosevelt, de nombreuses stars américaines venus soutenir les troupes américaines, surtout pendant la guerre...).
Georges Simenon y est passé et a été fasciné par l'atmosphère de Colòn. Il en a fait le cadre d'un de ses romans : "Quartier nègre".
La fierté des gens de Colòn fut longtemps d'avoir fourni au Panama plusieurs champions mondiaux de boxe, dont le célèbre "Panama Al brown", premier champion mondial sud-américain dans les années '30.
Panama city, la capitale, est une ville très étendue. De multiples faubourgs, à la croissance exponentielle, repoussent les limites de la ville vers l'intérieur du pays, et le long du canal. Le centre de la ville, proche du front de mer, est pronfondément américanisé. Grattes-ciel modernes, Mac Donald et pub pour Pepsi ne permettent pas de ditinguer Panaman de n'importe quel ville américaine du sud d'importance moyenne. Les les faubourgs industriels et certains quartiers résidentiels restent plus hispaniques. Il y avait un demi-million d'habitants en 1990, plus au moins un quart de million dans les villes contigues, que l'on peut estimer absobées par la ville.
Tous les vestiges archéologiques se trouvent bien sûr à l'emplacement du vieux Panama. En conséquence, la nouvelle ville est pauvre en monuments.
Balboa est une cité résidentielle,
le long du canal, au Nord du grand Panama, où se trouve le
yacht club. On y trouve beaucoup plus d'espaces verts, des parcs,
des terrains de sports. C'est un lieux agréable pour se promener,
quand on ne tient plus en place sur son bateau, accroché à
la bouée du yacht club.