Victor Segalen est le premier auteur à
avoir remis en question le regard européocentriste alors en vigueur
dans la littérature «exotique» de l’ère romantique.
Né à Brest en 1878, il fait des études de médecine
et est nommé à Tahiti en 1902. Il y reste trois ans.
Il découvre les œuvres de Gauguin, mort quelques mois avant son
arrivée. Avec lui, il pénètre le monde maori,
s’imprègne de la culture des vieux polynésiens, recueille
leurs légendes, et lit les récits des découvreurs
qui l’on précédés.
Rentré en France en 1905, il publie
« les Immémoriaux », roman ethnographique sur le Tahiti
d’autrefois et analyse aiguë des effets de l’évangélisation.
Il apprend ensuite le Chinois et part pour
la Chine en qualité d’élève-interprète de la
marine. Il accomplira plusieurs voyages en Chine centrale, où
il fera des découvertes archéologiques interessantes.
Il publie Stèles en 1910. Rappelé en France
pour la guerre, il publie Peintures. Après la guerre
il achève Equipée, journal poétique de ses
voyages en Chine. Il meurt accidentellement le 21 mai 1919.
Après sa mort, on publie Orphée-Roi (drame lyrique
dont Debussy devait composer la musique, 1921), René Leys
(1922), roman qui évoque la Cité interdite de Pékin,
et Equipée(1929).
Son talent ne fut pas reconnu de son vivant,
même si certains, tel le poète Rilke attirèrent l’attention
sur ces écrits. Aujourd’hui, « il rejoint lentement
la place qui lui revient entre Claudel et Saint-John Perse ».
Les
Immémoriaux
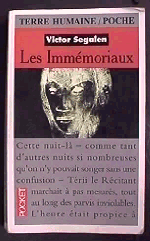 Les
« Immémoriaux », ce sont les derniers païens des
îles de la Polynésie, les Maoris oublieux de leurs coutumes,
de leur savoir, de leurs dieux familiers, en un mot de leur propre passé.
Segalen a redécouvert, puis recomposé ce passé suite
à la consultation d’une très riche documentation sur l’Océanie.
Il nous les présente par l’intermédiaire de Térii,
le récitant, héros du livre. Vivant à Tahiti,
il est initié, presque malgré lui, à des cosmogonies,
des légendes, une culture, qu’il néglige. Térii
quitte Tahiti pour voguer au hasard des cieux et des îles au moment
même où débarquent les premiers missionnaires méthodistes
anglais, armés de bibles, de codes et d’une morale exterminatrice.
Vingt ans plus tard, on le retrouve à Tahiti, ignorant et païen
au milieu des siens, orgueilleux de leurs nouveaux rites. Térii
s’abandonne, et se laisse baptiser et européaniser. Ainsi,
toute cette race, méconnaissant ses plus nécessaires instincts,
se renie avec désinvolture, et elle meurt. Les
« Immémoriaux », ce sont les derniers païens des
îles de la Polynésie, les Maoris oublieux de leurs coutumes,
de leur savoir, de leurs dieux familiers, en un mot de leur propre passé.
Segalen a redécouvert, puis recomposé ce passé suite
à la consultation d’une très riche documentation sur l’Océanie.
Il nous les présente par l’intermédiaire de Térii,
le récitant, héros du livre. Vivant à Tahiti,
il est initié, presque malgré lui, à des cosmogonies,
des légendes, une culture, qu’il néglige. Térii
quitte Tahiti pour voguer au hasard des cieux et des îles au moment
même où débarquent les premiers missionnaires méthodistes
anglais, armés de bibles, de codes et d’une morale exterminatrice.
Vingt ans plus tard, on le retrouve à Tahiti, ignorant et païen
au milieu des siens, orgueilleux de leurs nouveaux rites. Térii
s’abandonne, et se laisse baptiser et européaniser. Ainsi,
toute cette race, méconnaissant ses plus nécessaires instincts,
se renie avec désinvolture, et elle meurt.
C'est un ouvrage formidable, très
agréable à lire, par lequel on apprend beaucoup de la culture
des anciens polynésiens sans avoir l'impression de lire un manuel
d'ethnographie. Il est publié dans la collection Terre Humaine/Poche,
accompagné de dessins et de documents tahitiens, et d’importantes
annexes, qui reprennent les extraits des sources essentielles à
partir desquelles Segalen a décrit si finement les coutumes, les
croyances, la manière de sentir, ou de voir, des Maoris du début
du XIXè siècle.
Cette riche collection réunit de
nombreux ouvrages, dans le but de construire un nouveau savoir anthropologique.
Elle a publié les ouvrages de Jean Malaurie, de René Dumont,
de Claude Lévi-Strauss et bien d’autres.
|

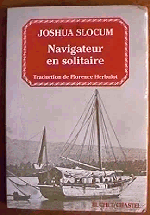 Honneur
au pionnier. Capitaine au long cours au chômage, Slocum entame
en avril 1895, à cinquante et un ans, le premier tour du monde à
la voile en solitaire sur le « Spray », sloop de 11 mètres.
Il reviendra à son port d’attache en juin 1898, après avoir
bouclé la boucle, doublé Bonne-Espérance, franchi
le détroit de Magellan, et vécu mille péripéties
dont il nous conte le détail dans un style délectable, plein
d’humour, de simplicité, de rudesse parfois aussi : « Seul
autour du monde sur un voilier de onze mètres » (Sailing alone
around the world), réédité dernièrement en
français sous le titre "Navigateur en solitaire".
Honneur
au pionnier. Capitaine au long cours au chômage, Slocum entame
en avril 1895, à cinquante et un ans, le premier tour du monde à
la voile en solitaire sur le « Spray », sloop de 11 mètres.
Il reviendra à son port d’attache en juin 1898, après avoir
bouclé la boucle, doublé Bonne-Espérance, franchi
le détroit de Magellan, et vécu mille péripéties
dont il nous conte le détail dans un style délectable, plein
d’humour, de simplicité, de rudesse parfois aussi : « Seul
autour du monde sur un voilier de onze mètres » (Sailing alone
around the world), réédité dernièrement en
français sous le titre "Navigateur en solitaire".
 C’est
au cours de la guerre de 14-18, en lisant « La croisière du
« Snark », de Jack London, qu’Alain Gerbault, ingénieur
et champion de tennis, mobilisé comme aviateur, eut l’idée
d’un tour du monde en solitaire à la voile. Il embarque en
1923 pour une traversée de l’Atlantique qu’il raconte dans «
Seul à travers l’Atlantique ». En 1924, il quitte New-York
pour Panama et les mers du Sud, où il s’arrête notamment aux
Galapagos, aux Gambier, aux Marquises, aux Tuamotu, aux îles de la
Société, aux Samoa. Ensuite, il traverse l’océan
Indien, double le cap de Bonne Espérance, touche Sainte-Hélène,
le Cap-Vert, et revient au Havre en 1929. Ce périple est conté
dans ses deux journaux de bord : « A la poursuite du soleil »
et « Sur la route du retour ».
C’est
au cours de la guerre de 14-18, en lisant « La croisière du
« Snark », de Jack London, qu’Alain Gerbault, ingénieur
et champion de tennis, mobilisé comme aviateur, eut l’idée
d’un tour du monde en solitaire à la voile. Il embarque en
1923 pour une traversée de l’Atlantique qu’il raconte dans «
Seul à travers l’Atlantique ». En 1924, il quitte New-York
pour Panama et les mers du Sud, où il s’arrête notamment aux
Galapagos, aux Gambier, aux Marquises, aux Tuamotu, aux îles de la
Société, aux Samoa. Ensuite, il traverse l’océan
Indien, double le cap de Bonne Espérance, touche Sainte-Hélène,
le Cap-Vert, et revient au Havre en 1929. Ce périple est conté
dans ses deux journaux de bord : « A la poursuite du soleil »
et « Sur la route du retour ».
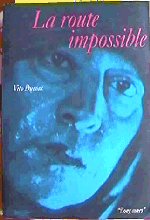 Dumas
est le premier a avoir osé ce qui est sans doute le plus hallucinant
des tours du monde en solitaire : le tour des quarantièmes rugissants.
La navigation comme seul projet, le combat avec la mer comme seule ambition,
Dumas est entré en navigation comme on entre en religion.
Dumas
est le premier a avoir osé ce qui est sans doute le plus hallucinant
des tours du monde en solitaire : le tour des quarantièmes rugissants.
La navigation comme seul projet, le combat avec la mer comme seule ambition,
Dumas est entré en navigation comme on entre en religion.
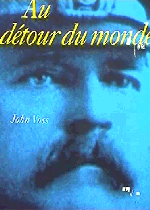 A
l’inverse de Slocum, qui très tôt, inspira de nombreux exégètes
pressés de lui rendre hommage, Voss ne connaîtra jamais la
célébrité. Pourtant ce marin exceptionnel, capitaine
de marine comme Slocum, a vécu des aventures marines étonnantes,
et les a superbement racontées dans son ouvrage « The venturesome
voyages », publié par EMOM sous le titre « Au détour
du monde ».
A
l’inverse de Slocum, qui très tôt, inspira de nombreux exégètes
pressés de lui rendre hommage, Voss ne connaîtra jamais la
célébrité. Pourtant ce marin exceptionnel, capitaine
de marine comme Slocum, a vécu des aventures marines étonnantes,
et les a superbement racontées dans son ouvrage « The venturesome
voyages », publié par EMOM sous le titre « Au détour
du monde ».
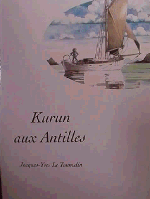 Fils
d’un marin breton exilé à Paris, Le Toumelin n’a de cesse
que de retourner sur l’eau. A 17 ans, il sait qu’il veut partir,
seul, à la voile autour du monde. Son projet sera retardé
par la seconde guerre mondiale, qu’il traverse inconscient, avec comme
seul souci la construction d’un bateau que les allemands lui volent et
perdent à la fin de la guerre. Finalement, 12 ans plus tard,
à 29 ans, le 19 septembre 1949, il appareille sur "Kurun", cotre
en bois à gréément aurique, sans moteur.
Fils
d’un marin breton exilé à Paris, Le Toumelin n’a de cesse
que de retourner sur l’eau. A 17 ans, il sait qu’il veut partir,
seul, à la voile autour du monde. Son projet sera retardé
par la seconde guerre mondiale, qu’il traverse inconscient, avec comme
seul souci la construction d’un bateau que les allemands lui volent et
perdent à la fin de la guerre. Finalement, 12 ans plus tard,
à 29 ans, le 19 septembre 1949, il appareille sur "Kurun", cotre
en bois à gréément aurique, sans moteur.
 Cependant,
les écrits de Heyerdahl sont palpitants et font preuve d’une logique
certaine qui font qu’il est apprécié par un large public
qui salue la démarche de l’homme. Heyerdahl
est aussi connu pour les recherches qu’il a effectué sur l’
Cependant,
les écrits de Heyerdahl sont palpitants et font preuve d’une logique
certaine qui font qu’il est apprécié par un large public
qui salue la démarche de l’homme. Heyerdahl
est aussi connu pour les recherches qu’il a effectué sur l’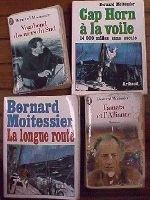 Le
plus beau des titres de Moitessier est sans aucun doute d’être l’auteur
qui a poussé sur l’eau le plus grand nombre de rêveurs.
Le
plus beau des titres de Moitessier est sans aucun doute d’être l’auteur
qui a poussé sur l’eau le plus grand nombre de rêveurs.
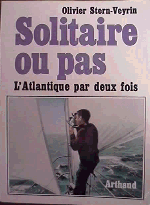 Le
docteur Stern-Veyrin traverse l'Atlantique par deux fois, sur son "Smile".
La première fois, il est accompagné de sa fille Ann, 13 ans.
Elle va devenir une équipière à part entière,
assumant ses quarts, et toutes les tâches du bord. Quand elle
rentre en France poursuivre ses études, son père ramène
le "Smile" en solitaire, par les Bermudes. Belle histoire humaine,
contée d'une belle plume.
Le
docteur Stern-Veyrin traverse l'Atlantique par deux fois, sur son "Smile".
La première fois, il est accompagné de sa fille Ann, 13 ans.
Elle va devenir une équipière à part entière,
assumant ses quarts, et toutes les tâches du bord. Quand elle
rentre en France poursuivre ses études, son père ramène
le "Smile" en solitaire, par les Bermudes. Belle histoire humaine,
contée d'une belle plume. Début
juillet 1979, Yves Pestel quitte Cherbourg pour se lancer sur les traces
de Vito Dumas : le tour du Monde par les trois caps à la voile et
en solitaire. "Spica", son petit voilier de neuf mètres, ne
posséde ni moteur, ni électronique, ni radio-émettrice.
Après avoir accompli la boucle, et viré le Horn, "Spica"
est renversé par une déferlante, et se redresse, mât
cassé. Pestel établi un gréément de fortune,
un rejoint sa seule escale, l'Argentine, après 338 jours de mer.
Pestel raconte ses aventures dans un style très riche, très
personnel, dévoilant l'expérience intérieure du marin.
Début
juillet 1979, Yves Pestel quitte Cherbourg pour se lancer sur les traces
de Vito Dumas : le tour du Monde par les trois caps à la voile et
en solitaire. "Spica", son petit voilier de neuf mètres, ne
posséde ni moteur, ni électronique, ni radio-émettrice.
Après avoir accompli la boucle, et viré le Horn, "Spica"
est renversé par une déferlante, et se redresse, mât
cassé. Pestel établi un gréément de fortune,
un rejoint sa seule escale, l'Argentine, après 338 jours de mer.
Pestel raconte ses aventures dans un style très riche, très
personnel, dévoilant l'expérience intérieure du marin.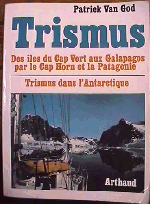 Encore
un belge ! Décidément, notre petit pays fournit bien des
voileux écrivains ! Peut-être parce ce que s’il ne fait pas
rêver, on n’y réprime pas les rêveurs…
Encore
un belge ! Décidément, notre petit pays fournit bien des
voileux écrivains ! Peut-être parce ce que s’il ne fait pas
rêver, on n’y réprime pas les rêveurs…
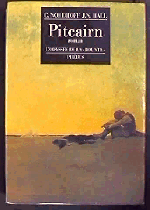 Charles
Nordhoff et James Norman Hall, qui étaient collaborateurs de la
revue « Atlantic Monthly » avant la grande guerre s’installèrent
à Tahiti une fois la paix revenue.
Charles
Nordhoff et James Norman Hall, qui étaient collaborateurs de la
revue « Atlantic Monthly » avant la grande guerre s’installèrent
à Tahiti une fois la paix revenue.
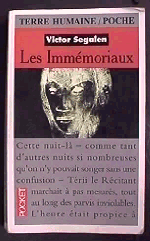 Les
« Immémoriaux », ce sont les derniers païens des
îles de la Polynésie, les Maoris oublieux de leurs coutumes,
de leur savoir, de leurs dieux familiers, en un mot de leur propre passé.
Segalen a redécouvert, puis recomposé ce passé suite
à la consultation d’une très riche documentation sur l’Océanie.
Il nous les présente par l’intermédiaire de Térii,
le récitant, héros du livre. Vivant à Tahiti,
il est initié, presque malgré lui, à des cosmogonies,
des légendes, une culture, qu’il néglige. Térii
quitte Tahiti pour voguer au hasard des cieux et des îles au moment
même où débarquent les premiers missionnaires méthodistes
anglais, armés de bibles, de codes et d’une morale exterminatrice.
Vingt ans plus tard, on le retrouve à Tahiti, ignorant et païen
au milieu des siens, orgueilleux de leurs nouveaux rites. Térii
s’abandonne, et se laisse baptiser et européaniser. Ainsi,
toute cette race, méconnaissant ses plus nécessaires instincts,
se renie avec désinvolture, et elle meurt.
Les
« Immémoriaux », ce sont les derniers païens des
îles de la Polynésie, les Maoris oublieux de leurs coutumes,
de leur savoir, de leurs dieux familiers, en un mot de leur propre passé.
Segalen a redécouvert, puis recomposé ce passé suite
à la consultation d’une très riche documentation sur l’Océanie.
Il nous les présente par l’intermédiaire de Térii,
le récitant, héros du livre. Vivant à Tahiti,
il est initié, presque malgré lui, à des cosmogonies,
des légendes, une culture, qu’il néglige. Térii
quitte Tahiti pour voguer au hasard des cieux et des îles au moment
même où débarquent les premiers missionnaires méthodistes
anglais, armés de bibles, de codes et d’une morale exterminatrice.
Vingt ans plus tard, on le retrouve à Tahiti, ignorant et païen
au milieu des siens, orgueilleux de leurs nouveaux rites. Térii
s’abandonne, et se laisse baptiser et européaniser. Ainsi,
toute cette race, méconnaissant ses plus nécessaires instincts,
se renie avec désinvolture, et elle meurt.
